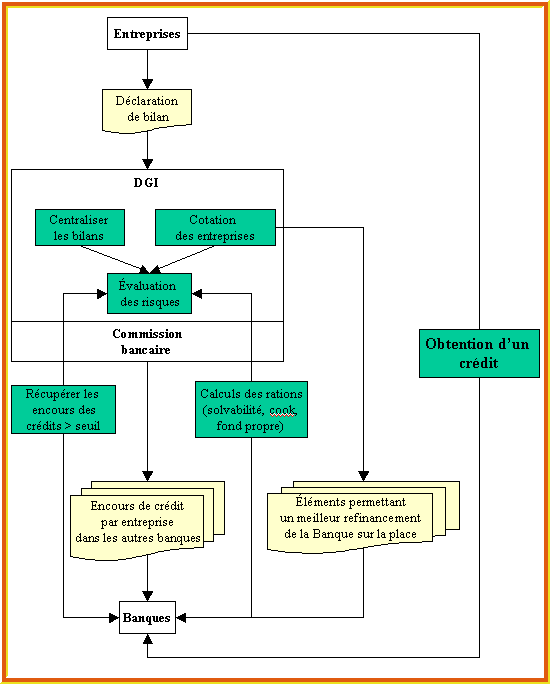De l'AF
vers l'AT...
Si l'on considère un processus
métier (ici, par exemple, l'obtention d'un crédit, point de
vue de la banque), on se rend vite compte que :
- des données internes ou externes à la banques sont
concernées ;
- plusieurs processus (calculs de ratios, détection d'encours
trop important, etc...) sont à mettre en oeuvre ;
A l'issue de votre architecture fonctionnelle, vous aurez, au
minimum :
- dressé un glossaire complet des données métier à
manipuler
- détaillée les différentes sources de données
- inventorié tous les processus métiers
- identifié le contexte à conserver par requête et par
session...
Par exemple, vous pouvez avoir opté pour une approche à base
de composant, comme celle illustré de façon
"générique" ci dessous :
|

architecture "technico-fonctionnelle" à base de composant
(mixte de l'architecture en couche
et celle à base de composant)
Pour bien comprendre en quoi ce n'est pas une
"architecture fonctionnelle", se reporter à
l'article du même nom : Architecture
Fonctionnelle
|
Et là, mon consultant
de 30 ans arrive, rigole un coup, vous met sous le
nez le schéma suivant :
|
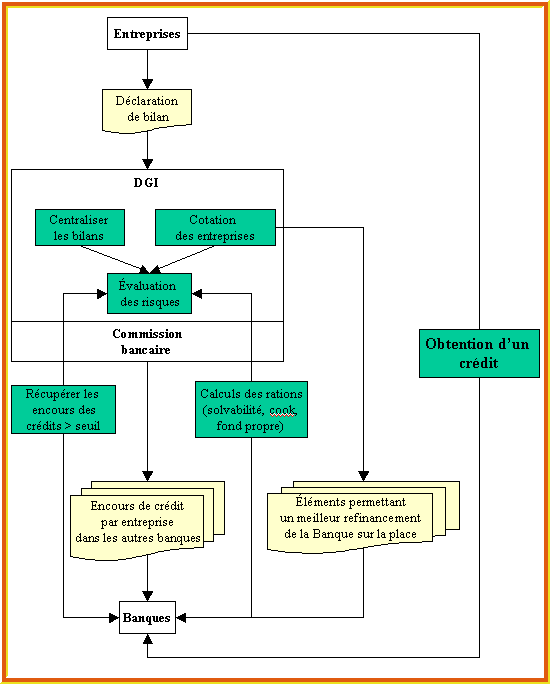
procédé métier : obtention d'un crédit
|
Ce schéma n'est pas là pour détailler
tous les mécanismes mis en oeuvre pour l'obtention d'un
crédit (je suis loin d'être un expert dans la finance et le
schéma est certainement très simplifié).
En revanche, il permet d'illustrer le
douloureux passage de l'AF (archi fonctionnelle) à l'AT
(archi technique), via les problèmes potentiels que pose un
tel processus.
En particulier, il y a fort à parier que
l'informatique et les données de la DGI (Direction Générale
des Impôts) ne soient pas compatibles avec celle de votre
banque. L'obtention d'un crédit, du point de vue de la
banque, c'est accéder à de nombreuses sources d'informations
hétérogènes, mettre en jeu de nombreux process.
Ce consultant
de 30 ans (toujours lui!) vous demandera alors si vous
avez :
- identifié les solutions concrètes d'accès aux données
des systèmes extérieurs ;
- réglé les problèmes de traduction de formats de ces
mêmes données ;
- repéré les goulots d'étranglement d'accès à ces
données ;
- mesuré les performances de chaque traitement...
De l'AT vers l'AF
Pour mieux illustrer les problèmes que met
en lumière une architecture technique (et qu'il faudra
prendre en compte et/ou intégrer dans l'architecture
fonctionnelle), on peut prendre l'exemple d'une autre
application bancaire : la consultation de ses actions.
Techniquement, vis-à-vis d'un système
aussi transverse, on parlera en architecture à niveau.
En particulier, on distinguera tout ce qui est
"front" (en liaison direct avec le/les clients), du
"back" (interne à la banque).
|

architecture technique d'un système de
consultation de titres
|
Cette architecture technique (même si
elle est encore bien incomplète) permet de visualiser deux Sphères
architecturales bien précises : le "front" et
le "back".
Elle doit aussi faire le point sur les
systèmes existants au sein de la banque et qui permette de
remplir le service. Ici, au niveau front, il y en a deux : un
système de web broker (système dédié interne à la banque)
et un système d'accès aux données distribuées (serveur de
page + serveur d'application).
Il conviendra alors de faire une synthèses
des caractéristiques fonctionnelles de ces systèmes
existants.
Ici, par exemple, on détaillera :
- le mode d'accès (unique ou multiple) ;
- la gestion des risques (délocalisée ou centralisée) ;
- la mise à jour du portefeuille du client (temps réel ou
différé) ;
- délai de réponse d'exécution des ordres boursiers ;
- etc...
En fonction de l'architecture technique, donc en fonction de :
- la "cartographie" des systèmes existants (ici
présentée sous forme de niveau, avec "front" et
"back") ;
- la liste des mode d'accès à ce service ;
- la visualisation "technique" des flux existants de
données (avec format, temps de réponse, ...) ;
on pourra plus facilement développer une architecture
fonctionnelle adaptée.
Par exemple, dans le cas d'une architecture
à base de composant,
on pourra se poser les bonnes questions lorsqu'il s'agira de
définir le composant :
* gestion de compte.
Faut-il prévoir un composant de gestion de compte par client
?
ou plutôt, toujours par client, 2 composants liés (un pour
les opérations bancaires - virements, etc. - et un dédié
aux opérations titre ?
* accès aux bourses étrangères.
Est-ce seulement possible, envisageable techniquement au vue
de l'infrastructure actuelle ? Quelles évolutions sont à
mettre en oeuvre techniquement pour que le composant
fonctionnel correspondant ait un sens ?
* interface client
Considérant l'architecture technique, n'est-il pas judicieux
de définir un composant fonctionnel d'interface
(entre les clients - web, minitel, agence, ... - et la banque)
?
Conclusion
Cet article ne prétend pas montrer
tout ce que recouvre l'architecture technique et
fonctionnelle. Ces 2 points
de vue majeurs ont par ailleurs été détaillés dans
l'article "Architectures,
les points de vue".
En revanche, il illustre la nécessaire
collaboration qui doit exister entre AF et AT.
|